Notes de lecture. Bernard Antony, Jaurès. Le mythe et la réalité (texte intégral)
Mise en ligne de La rédaction, le 9 août 2013.
Bernard Antony, Jaurès. Le mythe et la réalité Anet, Atelier Fol’fer, 2012
par Matthieu Lenoir
[ EXTRAITS DU NUMÉRO 40 / ÉTÉ 2013 ]
Le Jaurès que vient de nous livrer Bernard Antony comblera les amateurs d’histoire vivante. Vivante dans le sens où l’auteur-historien se fait enquêteur sur le terrain, généalogiste, psychologue, linguiste même pour nous offrir le premier ouvrage critique aussi complet sur cet étrange phénomène qui a donné son nom à des milliers de rues des cités de la république laïque et obligatoire du bon pays de France.
Jaurès est au premier abord l’archétype de la puissance physique et oratoire prisée par la France maçonnique de la fin du XIXe siècle. Enflure de discours bourrés de références littéraires et antiques, empruntant même parfois à un certain sentimentalisme chrétien fort en vogue à l’époque dans le camp d’en face. Cela pour orner un affichage brutal de postures idéologiques: laïcisme intégral, classisme prolétarien, pacifisme socialiste, anticléricalisme bouffon, progressisme scientiste… Bref tout l’attirail mental du prêt-à-penser social-séculariste dont Philippe Muray a si bien analysé les ressorts dans son XIXe siècle à travers les âges.
Antony nous fait découvrir toutefois un Jaurès aussi Janus qu’il paraît Saturne. Son amour néomarxiste du prolétariat ne l’empêche pas de recommander aux ouvriers coopérateurs de la Verrerie d’Albi d’obéir à leur patron, faute de quoi ils s’enliseraient dans leur chienlit. Son obsession anticléricale ne l’empêche pas de faire confirmer sa fille. Son pacifisme manifeste d’évidentes limites avec son idéal de république milicienne et d’école-caserne, prôné au long du monumental ouvrage, L’Armée nouvelle. Son dreyfusisme est tempéré par ses hésitations initiales, son admiration pour un Marx déclarant que «l’élimination du trafic de la société rendrait le juif impossible» et sa proximité avec une culture sociale-populaire marquée par un antisémitisme de gauche franc et massif. Son soutien à la cause des Arméniens crucifiés par le fanatisme turc, impérial puis maçonnique jeune-turc, est démonétisé par son opposition à toute intervention française. Son culte de l’étatisation des consciences contredit son ode à la famille, qui le ferait passer aujourd’hui pour pétainiste. Et l’on pourrait soutenir, non sans ironie, que son antichristianisme viscéral ne se concrétise même pas, d’après Antony, par une initiation dans l’une de ces loges qui rivalisaient de haine dans la «révolution culturelle» de la IIIe République naissante, avec son expulsion des congrégations et sa loi de séparation des Églises et de l’État, révolution cache-sexe d’un affairisme sans limite.
Parmi les qualités d’Antony, trois nous paraissent décisives pour cette étude. D’abord, enfant du pays tarnais, il est à même de lier histoire nationale et histoire locale, de superposer les grands discours du maître en socialisme à son intimité familiale, l’effort intellectuel de ce normalien brillant à son rapport intime aux femmes (fort distant) ou à sa propre image physique (bien dégradée). Les idées sont issues des hommes et les hommes sont aussi de chair et de sang.
Ensuite, cette vaste érudition qui lui permet de relier le «cas» Jaurès au continuum historique de ce terrible tournant de siècle. Guerre de religion inavouée en France, entre cet «occulto-socialisme» gnostique ou athée, son pullulement de sectes, et l’Église catholique à peine remise des massacres qui l’épuisèrent sous la Terreur, voire le protestantisme et le judaïsme. Antony pénètre jusqu’à l’intimité spirituelle de Jaurès pour y déceler, dans les replis de ses écrits, ce glissement décisif du Dieu-altérité vers la déification égotique via un panthéisme de bricolage. Jaurès l’inépuisable tribun, relève Antony, c’est l’annonce des discours-fleuves prétendant épuiser le réel d’un Castro, d’un Souslov ou d’un Enver Hodja, ce dernier diplômé de la Sorbonne. Tandis que Jaurès pérorait, à ses côtés au Bureau socialiste international, Lénine éructait ses discours de haine de classe qui plus tard iraient remplir des étalages entiers de bibliothèques.
Antony, enfin, offre une nouvelle fois à l’esprit actuel sa subtile et courageuse liberté de dire. Il cède parfois à ses préférences historiques, à ses sympathies culturelles au détriment d’une démarche plus froidement «universitaire». Et alors? Une part de subjectivité signe la sincérité du propos. Le prétentieux rationalisme des clercs cache, trop souvent, un biais idéologique d’autant plus sectaire qu’il est occulté. Antony est libre face aux repentances obligatoires, comme face aux cultes laïques et marxistes. Il aère, disperse et ventile le monde étouffant de l’utopie socialiste, de son constructivisme anthropocentrique, de son apostasie, de ses haines et de ces coteries dominées par les demi-dieux de l’égalitarisme émancipateur.
La paradoxale et surabondante pensée de Jaurès pourrait sembler pour le moins confuse si elle n’était axée sur un désaxement. Celui du rejet viscéral du Dieu tout autre, du Dieu alpha et oméga, du Dieu incarné, au bénéfice d’une déification de soi, d’un panthéisme
hugolien. Au début de son Histoire socialiste de la Révolution française (le titre en dit long), le tolérant Jaurès souhaite «non seulement la laïcité complète de l’État, mais la disparition même de l’Église et même du christianisme». Une radicalité de banquet républicain qu’il déclinera en imprécations contre les «jésuites», têtes de turcs, si l’on ose écrire, du maçonnisme provincial après avoir été celles de l’absolutisme monarchique. Monsieur Jaurès va jusqu’à enjoindre l’ex-séminariste Émile Combes, président du Conseil, auteur des lois d’expropriation et de censure contre le catholicisme, fomenteur du flicage généralisé de l’armée (l’affaire des «fiches») à aller plus loin que la fermeture de milliers d’écoles lors de l’expulsion des congrégations, sous le prétexte que l’Église fût antidreyfusarde. «Il y a des crimes politiques et sociaux qui se paient, et le grand crime collectif commis par l’Église contre la vérité, contre l’humanité, contre le droit et contre la République va recevoir son juste salaire», menace l’émancipateur du prolétariat. Le vociférateur a pourtant les mains sales. N’hésitant pas à manier le terme de «juiverie», Jaurès avait quelques années auparavant encensé Édouard Drumont: «Comme Marx, il aurait pu montrer que la conception sociale des juifs, fondée sur l’idée de trafic, est en parfaite harmonie avec le mécanisme du capital», écrit-il, dénonçant l’action «démesurée et redoutable» des juifs dans «notre société». Et c’est ce même Jaurès qui avait dénoncé à la chambre, avant sa conversion au dreyfusisme, la non-condamnation à mort du capitaine comme «une manifestation de l’esprit de caste de la haute armée», avant de s’abstenir sur un texte opposé à la demande de révision du procès pour haute trahison!
Certes, précise Antony, Jaurès n’alla pas jusqu’à écrire des poèmes à Satan comme le fit Marx ou à théoriser le culte du mal comme le firent Netchaïev et Bakounine dans leur Catéchisme révolutionnaire. Mais sa pensée, aussi tempétueuse fût-elle, est bien celle de la sécularisation forcenée de l’Espérance, de la prétention à établir ici-bas un paradis pour le surhomme dieu, concept que Jaurès n’hésita pas à emprunter à Nietzsche.
Au final, derrière l’imprégnation marxiste, derrière la haine de l’Église et du christianisme, derrière l’enflure de l’ego, derrière les prétentieuses circonvolutions dialectiques sur les sujets concrets d’administration du pays, l’illustre Jean Jaurès, qui aura donné son nom en France à des milliers d’écoles, des kilomètres de rues et même à une éminente fondation de penseurs socialistes à un siècle de distance, n’est guère que la caricature du parfait bourgeois voltairien en mal de reconnaissance populaire. Son interprétation de la Révolution française est à cet égard révélatrice. «La classe bourgeoise et industrielle était pénétrée de la grandeur de son rôle», s’extasie-t-il dans son Histoire socialiste de la Révolution française, en omettant l’œuvre de destruction systématique des organisations ouvrières entreprise par icelle via sa loi Le Chapelier. Simultanément, il redit son exécration pour «l’étreinte sauvage des moines», et déclare que si l’Église «possédait des couvents, des hôpitaux, des abbayes sans nombre», c’était pour nourrir «une énorme clientèle de mendiants ou de pauvres». Une «clientèle», avons-nous bien lu.
Jean Jaurès, falsificateur au service de la prise de pouvoir absolue – sociale, intellectuelle, spirituelle – par l’encadrement productiviste du pays. Voilà la réalité que nous dévoile Bernard Antony. La vitupération de «l’absolutisme» et de la «tyrannie» cache mal l’occultation d’un totalitarisme d’un autre ordre, soit l’accaparement d’une société entière par la praxis matérialiste, l’économisme, la réduction de l’homme à l’homme, l’hédonisme pour horizon indépassable.
Que les «bourgeoisies» étatiste, entrepreneuriale, syndicale ou communicationnelle de nos sociétés postindustrielles célèbrent le culte du type de grand ancêtre qu’incarne Jaurès est dans l’ordre des choses. Nous écrivons bien: des choses.
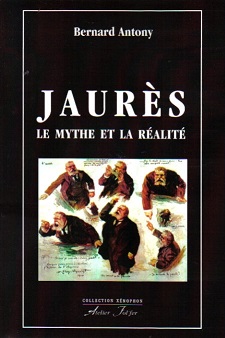
Écrire un commentaire
You must be logged in to post a comment.