Le siècle, les hommes, les idées. Une vue synoptique d’Entailles II (texte intégral)
Mise en ligne de La rédaction, le 19 décembre 2016.
par Jean Renaud
[ EXTRAITS DU NUMÉRO 52/NOVEMBRE 2016-JANVIER 2017 ]
Discours prononcé le 22 septembre 2016, à l’occasion du lancement des Éditions Synoptique et du livre Entailles II de Patrick Dionne, en vente à la Librairie Le Port de tête, 262, av. Mont-Royal Est, Montréal, Tél: 514 678-9566 (librairie@leportdetete.com).
«Écrire, quelle disgrâce! », grommelait Cioran.
On n’écrit pas pour écrire, on écrit parce qu’on cherche autre chose. Le fait est qu’on le cherche avec des mots. Cette confiance dans les mots n’est pas toujours consciente, ni toujours assurée, mais elle établit un premier clivage métaphysique et esthétique:
«Un nom est une définition», lit-on dans Entailles II.
Cette confiance est toujours en péril, toujours à restaurer. Je devine en filigrane dans l’œuvre de Patrick Dionne la menace du nihilisme, une menace que les chrétiens sous-estiment en général, réfugiés dans un sentimentalisme qui se contente de peu et qui est une des plaies de notre temps.
Je ne crois pas qu’on puisse comprendre le nihilisme en restant à distance, le nihilisme étant pour ainsi dire l’expérience fondamentale, quasi inévitable, du moderne lorsqu’il s’échappe, plus ou moins volontairement, de ce que j’appelle, peut-être en contradiction avec Patrick Dionne, « romantisme » (celui-ci étant en somme cela même que la plupart de nos contemporains entendent par « littérature ») – un romantisme quelquefois mâtiné de christianisme –, c’est-à-dire une façon de ne pas prendre au sérieux la puissance propre du nihilisme et l’espèce de lien « dialectique » (pardonnez-moi d’employer ce mot gâché par le marxisme) qui le rattache au christianisme. Le nihilisme est le christianisme en creux, son accomplissement à rebours… En un sens, être chrétien nous met en danger. Ce rapport entre le christianisme et le nihilisme est au moins suggéré par notre auteur, dans un de ses aphorismes que je vous laisse découvrir par vous-mêmes…
Un mot sur l’aphorisme
Quelques mots sur le genre utilisé : l’aphorisme. Pour Karl Kraus : «L’aphorisme ne recouvre jamais la vérité; il est soit une demi-vérité, soit une vérité et demie» (Dits et contredits).
La première fois que j’ai lu cet aphorisme de Karl Kraus, je me suis dit, en jeune homme que j’étais alors, qu’il me fallait chasser les demi-vérités au profit des vérités et demie. C’est avec le temps que j’ai pu reconnaître que la demi-vérité pouvait être vérité à l’état naissant, une manière de faire crédit au lecteur, cet effort d’attention qu’on lui impose lui permettant de s’assimiler la vérité dans son âme et dans son corps, comme une chose vivante. L’aphorisme est généralement le plus légèrement vêtu des genres littéraires. La lumière est quelquefois son unique ornement… J’ajouterais avec un très grand écrivain, Joubert, dont l’ombre est présente dans l’œuvre de Patrick Dionne, que l’aphorisme est surtout, ou devrait surtout être, une semence :
«Il faut (peut-être) jeter dans les esprits des semences (seulement) et non y planter des arbres morts et des plantes toutes venues.»
Reprochera-t-on à Patrick Dionne d’être trop elliptique, ou trop flou, préférant les métaphores aux arguments proprement dits? Ici, j’ai en tête une remarque de Joubert, encore (quand je parle de Patrick Dionne, je songe souvent à Joubert, le «Saint Patron du Style», comme le qualifie l’auteur d’Entailles).
«Les anciens se servaient ordinairement du mot vague le plus voisin du mot précis, afin de causer plus de plaisir à l’attention.»
Cela rejoint un mot de Heidegger pour qui la science ne pense pas. Elle ne pense pas puisqu’elle calcule. Ce même Heidegger n’a pas tort de soutenir – dans un sens assez différent de Chestov par exemple – que la raison est l’adversaire de la métaphysique. La raison est incapable de se limiter, elle est incapable d’écouter, elle est incapable d’humilité. Yves Bonnefoy, que Patrick Dionne n’apprécie guère je crois, au moins comme traducteur, écrit dans L’Improbable que le concept «est une apostasie sans fin de ce qui est». L’apostasie sans fin de ce qui est, définition parfaite de notre odieuse modernité.
L’expert, le spécialiste, est celui qui a la vocation sinon la capacité de remplacer ce qui est par un simulacre, un double, un produit né de son cerveau… Ce simulacre est à la fois rationnel – une création de la raison – et parfaitement absurde, appelé à satisfaire une pulsion, une envie, un désir momentané, une perversion (les perversions existent), etc.
J’oserais soutenir que la raison doit être domptée par le cœur – ce cœur qu’il ne faut pas confondre avec un sentiment déréglé :
«Tout est lié au cœur.
Tout en part, tout y revient», écrit Patrick Dionne.
Le cœur, synonyme auguste du bien, scandait Maurras, un cœur réglé non sur la raison, non sur le machinal ou le calcul, mais sur une nature des choses, sagesse humaine d’Horace ou de La Fontaine – l’écho d’Horace est présent dans Entailles II –, humble et faillible sagesse elle-même corrigée autant qu’assurée par une transcendance personnelle, réelle, agissante, capable d’aimer et de donner, et aussi de définir, c’est-à-dire d’établir les bornes et les limites…
«Le ciel est la grammaire; la terre est le poème.»
Cet aphorisme a une connotation à la fois esthétique et théologique… Ce n’est pas le seul:
«L’informe est le sceau du diable.»
On trouve beaucoup d’aphorismes ayant une portée esthétique dans cet ouvrage. Ceci, qui a l’air de rien, offre un exemple de ce que j’appellerais une demi-vérité féconde, en laissant aux lecteurs un ample espace pour la rêverie et la méditation:
«Un style énervé se trahit par ses tics.»
À l’opposé de ce trait, j’ai songé à cet hommage de Samuel Johnson au style de John Dryden: « Celui qui écrit beaucoup échappera difficilement au maniérisme c’est-à-dire un retour fréquent à des modes particuliers qu’il n’est pas malaisé de déceler. Dryden est toujours un autre et le même; il ne déploie pas une seconde fois les mêmes élégances sous la même forme, et ne paraît pas non plus avoir d’autre art que celui d’exprimer avec clarté ce qu’il pense avec vigueur. On ne pourrait pas facilement imiter son style, que ce soit sérieusement, ou pour le ridiculiser, car, comme il est toujours identique à lui-même, et toujours varié, il n’a pas de caractère prédominant et distinctif.» Bref, le classique n’a pas de tics.
Présence d’Éros
Entailles II est plus poétique dirais-je, au sens le plus noble, que le premier Entailles, plus grec que latin, plus platonicien – dans la forme à tout le moins –, plus aérien. J’aime beaucoup :
«Elle, aile.
Des synonymes, parfois.»
On notera ici une tonalité érotique, très présente dans ce second Entailles. Éros a mauvaise réputation chez les chrétiens, d’autant plus que nous sommes tous plus ou moins protestantisés. Pour donner deux exemples d’illustres théologiens protestants, par ailleurs importants : Karl Barth et Anders Nygren (l’auteur du célèbre Éros et Agapê) eurent tendance à calomnier Éros, à lui refuser tout rôle bénéfique, lui opposant la « charité », agapê ou caritas.
Les modernes, qui se croient libérés de Calvin tendent, eux, à évacuer Éros au profit d’un désir sexuel isolé de l’amour et de la fidélité. Ce sexe poursuivi pour lui-même et en lui-même, est non seulement sans joie, mais aussi sans plaisir. Il ressent vite le besoin de l’aberrant pour se perpétuer. Pour paraphraser Laclos, l’homme des basses-œuvres de Philippe Égalité, il n’y a plus que les choses bizarres qui l’intéressent.
Dans cette hyper-sexualisation, la feuille de vigne se déplace : au lieu de cacher les parties intimes, elle dissimule les visages (la remarque est de Fromm), c’est-à-dire la personne, son identité, l’autre en tant qu’autre (on pourrait soupçonner une sorte d’analogie entre sexualisation et burqa : ce que la pornographie ne montre jamais, c’est le visage).
La condamnation protestante d’Éros et la sexualisation moderne enlèvent à l’érotisme – et je dirais à l’érotique, en substantivant le mot – son caractère de médiation que lui reconnaissaient Platon ou saint Thomas et qu’il tient tout simplement de la nature, une nature essentiellement bonne quoique souvent incapable d’achever ce qu’elle a commencé.
«Point de volupté sans recueillement», pour Patrick Dionne.
Nous sommes devenus incapables d’incorporer «la règle à l’instinct, l’art à la nature, la pensée à la vie*», la volupté à la vertu… Mais une telle incorporation définit l’art d’écrire, ainsi que l’art de vivre, et même l’art culinaire, sans oublier dans la continuité d’Entailles II, l’art d’aimer… Et j’ajouterais qu’elle définit toute civilisation, sauf celles qui se défont.
Voilà justement l’une des caractéristiques de la modernité. Elle est dissociation. L’esprit se sépare de l’instinct, la pensée de la vie; la vertu attriste et le plaisir avilit. La modernité est atomisation (Nietzsche l’avait discerné), fragmentation. «La quantité de fragments me déchire», écrivait René Char. Le mal ne compose pas: il dissout. Ce qui est naturel se confond avec la barbarie; ce qui est rationnel avec une forgerie.
Nous sommes devant deux formes de barbarie: celle d’une nature décérébrée et celle d’une pensée dénaturée, hors de ses gonds.
«Le patriciat dans l’ordre des faits, mais une barbarie vraiment démocratique dans la pensée», prédisait Maurras au début du XXe siècle.
Une vue synoptique des choses
L’auteur d’Entailles II se défend de la séparation ontologique par la métaphore ou l’analogie. Et celles-ci supposent, pour être non seulement belles mais justes, un ordre préalable ouvrant la voie à des correspondances entre l’un et le multiple.
J’en arrive au nom de la maison d’édition: Synoptique. Συνοπτικος (sunoptikos): Qui voit l’ensemble d’un seul coup d’œil. Dans le verbe συνοραω (sunoraô) – voir ensemble ou à la fois, embrasser d’un seul coup d’œil – l’on trouve οραω (« voir ») et le «syn» qui correspond au «cum» latin et signifie «avec». Pour voir, il faut ouvrir les yeux. Pour voir beaucoup de choses à la fois, il faut ouvrir grand les yeux, si je puis dire. Je paraphraserais Patrick Dionne en disant qu’il n’y a pas de vision sans recueillement.
Ouvrons Les Lois, un ouvrage de vieillesse de Platon :
«[…] il faut être capable non seulement d’envisager le multiple, mais aussi de pousser jusqu’à la connaissance de l’un, et, l’ayant connu, d’y ordonner synoptiquement tout le reste*» (Συνορϖντα, sunorônta).
On ne traite pas du multiple sans le rapporter à l’Un. Et on ne voit pas l’Un sans se régler sur lui.
Les conservateurs parlent souvent – après Maurras et sans le nommer – du pays réel. Mais qui ou quoi représente le pays réel? Un Américain pourrait désigner Donald Trump ou ceux qui votent pour Trump. Un Anglais suggèrerait le nom de Boris Johnson ou de quelque autre politicien favorable au Brexit. Un Québécois, je ne sais plus ce qu’il dirait. Et d’ailleurs ça n’a pas d’importance.
Le pays réel, répondait Pierre Boutang, c’est le sacré, c’est la transcendance, et on revient au mot «synoptique», c’est le multiple qui sait se rapporter à l’Un et qui s’en nourrit.
Le seul contrepoids au pays légal, capable de mettre une borne, une frontière, aux forces d’asservissement qui prennent le masque de la libération, c’est le sacré. Au fond, on retrouve cette idée dans l’ouvrage le plus méconnu ou le plus mal lu de Joseph de Maistre: Du Pape.
Mais qu’est-ce qu’un pays réel que personne n’habite plus ? En fait, il serait plus juste de dire que presque personne n’habite le pays réel. On méconnaît – et tout nous porte à une telle méconnaissance – le mystère du «je-ne-sais-quoi» et du «presque rien», médité par Jankélévitch, la valeur de ce qui paraît pauvre et inutile. Je souligne que l’aphorisme n’est pas sans rapport avec le peu. Il se tient près du silence, pour paraphraser Patrick Dionne. La fable également est de basse extraction. Nulle trace de l’apologue ésopique, le Cendrillon des belles-lettres, dit Fumaroli, dans L’Art poétique de Boileau (1674).
Les Fables de La Fontaine sont contemporaines de la mode des maximes lancée par le cercle des amis de la marquise de Sablé, auquel appartenait La Rochefoucauld, l’un des maîtres de Patrick Dionne. «Les gens comprennent tous l’utilité de ce qui est utile, mais ils ignorent l’utilité de l’inutile.» La belle maxime nous vient de Tchouang-tseu. Pauvre et peu ont la même origine. «La valeur du “peu”, témoignait un Jean Giono vieillissant, la valeur de très peu de chose. On s’étonne du peu qu’il faut pour vivre, non seulement pour vivre simplement, mais pour vivre royalement; du moment qu’on sait vivre.» «Être un homme de la crèche», propose à son tour Patrick Dionne. Le mépris du pauvre qui distingue notre époque témoigne d’une apostasie.
Qu’est-ce qui est réel, sinon l’Un? Et ces choses multiples qui ne se rapportent plus à l’Un ne perdent-elles pas toute réalité? Le multiple sans lien avec l’Un n’est plus que poussière, il se déréalise. La décréation du monde, qu’évoquait Péguy, c’est précisément cela.
Ce qui relie les hommes est situé au-dessus d’eux. On ne lie pas les hommes entre eux par un cours d’éducation civique, comme le croient nos candides nationalistes. Rien n’est plus propre à dégoûter de sa patrie qu’un manuel rédigé par des technocrates. Tout le patrimoine intellectuel, moral et spirituel de l’Occident est en jeu et dans cet appel à la piété, à l’attention, au sacrifice également, la littérature au sens large, qui inclut la poésie et la théologie («Poésie est théologie» pour Boccace), la littérature, dis-je, a un rôle éminent quoique secret.
«En un mot, écrit le cardinal Newman dans L’Idée d’université, la vérité religieuse n’est pas seulement une portion, mais une condition de la connaissance générale*. »
Pour paraphraser une dernière fois Patrick Dionne, ce qui ne parle pas de Dieu ne dit plus rien, ni au cœur ni à l’esprit.
__________________________________________________________________
* On reconnaît un membre de phrase tiré de la conclusion de l’« Auguste Comte » de Maurras (L’Avenir de l’Intelligence).
** Traduction d’Auguste Diès. Voici celle, un peu plus ancienne, d’Émile Chambry: «[Ils devraient] être capables non seulement de porter leurs regards sur plusieurs objets, mais encore tendre à un but unique, le bien et, l’ayant connu, se régler sur lui en embrassant tout d’une seule vue».
*** Je me tiens proche ici de la version originale. La traduction d’Edmond Robillard et de Maurice Labelle est plus élégante : «En un mot: la vérité religieuse n’est pas seulement une portion du savoir universel, elle est plutôt une condition indispensable à l’existence du savoir en général» (John Henry Newman, L’Idée d’université, vers la fin du 3e discours).
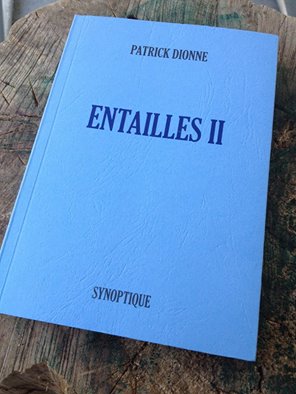
Écrire un commentaire
You must be logged in to post a comment.